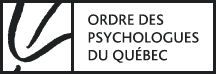Mythes et réalités sur les troubles alimentaires avec le Dr Howard Steiger, psychologue
Éveline Marcil-Denault, psychologue et rédactrice pigiste

S’ils ont longtemps été perçus comme un produit des pressions socioculturelles, les troubles de l’alimentation sont maintenant considérés par les chercheurs comme très héréditaires. « Les personnes ne développent pas ces troubles par manque de force de caractère ou par le fait qu’elles sont capricieuses, superficielles ou trop axées sur l’apparence, explique le Dr Steiger. Elles les développent parce que des vulnérabilités véritables sont allumées par les pressions environnementales, dont celle vers la minceur. »
À qui la faute?
« Quand j’ai commencé, on pointait du doigt les mères et les familles pour expliquer les causes des troubles alimentaires », relate le Dr Steiger. Il cite la « parentectomie », traitement parfois préconisé à l’époque, qui consistait à sauver l’enfant de l’emprise nocive des parents. Le terme est lourd de sens. « C’était culpabilisant pour les parents, qui se demandaient ce qu’ils avaient fait de mal ou qui se blâmaient d’avoir fait suivre un régime alimentaire à leur fille de 7 ans. »
Les recherches contemporaines mettent plutôt en évidence la conjonction complexe entre les vulnérabilités constitutionnelles – portées par la personne ou développées à travers son expérience – et les pressions environnementales. Aujourd’hui, le Dr Steiger considère que la personne traitée fait face à un désordre externe qui la dépasse. « La famille doit être renseignée sur le fait qu’on est là pour aider une personne à maîtriser une peur plus grande qu’elle. »
Petite leçon d’épigénétique
Le Dr Steiger s’est intéressé aux traits de personnalité, puis aux indicateurs biologiques, neurobiologiques et génétiques pouvant jouer un rôle dans l’étiologie des troubles. Ces derniers temps, l’épigénétique est au cœur des travaux menés par son équipe. Épi signifie au-dessus. On parle donc des processus qui contrôlent l’expression des gènes. Car, précise le professeur, un gène n’est pas déterminant en lui-même : comme un interrupteur en position marche ou arrêt, il doit être soit activé ou désactivé. Le génome est fixe, mais l’épigénome fluctue sans cesse.
La méthylation – processus par lequel les molécules de méthyle fusionnent avec le génome – est un marqueur de ces processus. « L’effet principal de la méthylation est d’éteindre les gènes », explique le Dr Steiger. Ce type de recherche met en lumière la mécanique de déclenchement des vulnérabilités. « On découvre que l’état nutritionnel est un facteur épigénétique très important. Comme certains nutriments sont des donateurs de méthyle, une personne privée de ceux-ci va altérer la répartition de la méthylation sur le génome. »
Le Dr Steiger cite des données suggérant que, chez les femmes boulimiques, s’il y a une instabilité émotionnelle importante – particulièrement chez celles qui ont subi des traumatismes dans l’enfance – on voit plus de méthylation sur des gènes responsables de l’accommodation au stress, à l’humeur et à l’impulsivité. En d’autres mots, leurs capacités d’adaptation sont amoindries. Fait intéressant : « des études semblent indiquer que la psychothérapie peut entraîner une normalisation des anomalies épigénétiques ou, à tout le moins, nous observons des marqueurs physiologiques d’un certain ajustement de l’état de détresse de la personne. »
La peur des chiens
« La personne souffrant d’un trouble alimentaire a une phobie massive de la prise de poids ou de la perte de contrôle sur la prise de poids », explique le Dr Steiger, qui soutient que, contrairement à la croyance populaire, la personne atteinte d’anorexie nerveuse réalise que sa conduite est nocive pour sa santé. « Elle sait qu’elle est maigre et qu’elle devrait changer, mais c’est tellement pénible pour elle de le faire. » Quelques bouchées, décrit-il, entraînent pour certaines une journée de ruminations intenses. D’où certains choix : « une fille qui a un examen préférera ne pas manger pour éviter d’être déconcentrée. »
Bref, manger équivaut à souffrir. « Elle se sent grosse et a un dédain pour elle-même. Elle a peur d’où cela pourrait la mener. » Or, si la plupart des gens sont empathiques devant quelqu’un qui a la phobie des chiens, une anorexique n’a pas toujours droit à la même compréhension, observe le Dr Steiger. « Personne ne songerait à lancer quelqu’un qui a la phobie des chiens dans une pièce pleine de dobermans! » À Douglas, il arrive que des intervenants demandent à leurs patientes : « as-tu flatté le chien aujourd’hui? » Cette question signifie : « as-tu mangé trois repas? » ou « as-tu utilisé les repas comme exposition à une chose dont tu as peur et que tu as besoin de maîtriser? ».
Ce n’est pas en forçant la personne à manger qu’on l’aide, insiste le Dr Steiger, c’est en aidant la personne à développer une sécurité autour de l’alimentation.
Les femmes, les hommes et le poids
L’association femme et trouble de l’alimentation n’est pas un mythe : la population la plus à risque est celle des jeunes femmes de 12 à 30 ans, confirme le spécialiste. En général, 1 % d’entre elles souffrent d’anorexie nerveuse et 2 % de boulimie. Il précise que pour l’anorexie nerveuse, un homme pour dix femmes en est touché; c’est deux ou trois hommes pour dix femmes pour la boulimie.
Cela dit, la boulimie serait actuellement en croissance chez les hommes. Bien que les problèmes alimentaires touchent un groupe de population très hétérogène, la boulimie est un peu plus associée aux groupes plus défavorisés, ajoute le spécialiste.
Certains traits ressortent chez les personnes souffrant d’anorexie nerveuse dans sa forme restrictive – sans boulimie et sans purge : « tendances perfectionnistes, désir de contrôle, préférences pour l’ordre, inhibition émotionnelle. » Ces traits sont associés au risque en partie à cause de l’hérédité et de l’apprentissage, explique le psychologue, mais la dénutrition amplifie l’obsessionnalité et la compulsivité : « une personne qui avait déjà ces tendances les verra s’accentuer avec la dénutrition. »
L’imagerie cérébrale tend selon lui à confirmer ces observations : « l’anorexie est associée à une inhibition excessive au niveau frontal et à une dérégulation dans la région de l’insula. À l’inverse, la boulimie est plutôt associée à une hypofrontalité – soit à un manque d’inhibition frontale, une impulsivité. »
DSM-5 : la confirmation d’un problème préoccupant
Le DSM-5 officialise un diagnostic provisoire du DSM-IV appelé l’hyperphagie boulimique, qui s’observe par des épisodes d’orgies alimentaires à répétition et sans compensation – donc sans vomissement ou jeûnes – amenant la personne à se rendre obèse. La honte est l’un des symptômes qui y sont associés : « la personne mange en clandestinité. »
Une récente étude épidémiologique menée auprès de femmes adultes âgées de 20 à 40 ans par le Dr Steiger et la Dre Lise Gauvin indique une prévalence de 3,8 %. Ce trouble atteindrait plus souvent des personnes dans la quarantaine, dans une proportion de deux hommes pour trois femmes. Selon le Dr Steiger, il recèlerait une composante psychologique importante : problèmes d’ajustement émotionnel, instabilité affective, problème de contrôle des pulsions. Pour le moment, les spécialistes de Douglas ne traitent pas de patients atteints d’hyperphagie.
Pulsion de mort?
Plusieurs s’imaginent qu’une tendance suicidaire se cache derrière des conduites alimentaires dangereuses. « On peut devenir suicidaire quand on a l’anorexie nerveuse comme on peut devenir suicidaire dans n’importe quel autre contexte », recadre le Dr Steiger. Selon lui, l’objectif des personnes anorexiques n’est pas de mourir, il s’agit plutôt d’un effort mal guidé et désespéré de se sentir bien. « C’est très important pour les thérapeutes de reconnaître ça », ajoute-t-il.
L’anorexie nerveuse, rappelle-t-il néanmoins, a le taux de mortalité le plus élevé de tous les troubles de santé mentale. Actuellement, une personne qui souffre d’anorexie sur une période de 10 ans a un risque de 5 % d’en mourir, confirme le Dr Steiger en précisant que la cause de décès est souvent la crise cardiaque soudaine causée par l’hypokaliémie – la chute du taux de potassium à un niveau trop faible.
Éviter l’iceberg
Certains des comportements adoptés par les personnes anorexiques ou boulimiques pour gérer leur anxiété et minimiser leur poids causent l’hypokaliémie, comme se faire vomir régulièrement ou se sous-alimenter intensément, explique le psychologue.
Ces personnes, dit-il, ont besoin de situer les limites auxquelles on établit une dangerosité. Le but est de créer une forme d’alliance sur la maîtrise des comportements qui causent l’hypokaliémie. « Si on était tous les deux dans un bateau, on essaierait de naviguer de manière à ne pas frapper l’iceberg. Il faut non seulement savoir où est l’iceberg, mais savoir quelles sont les indications du risque de ne plus pouvoir tourner assez rapidement. »
Copilote au lieu de policier
En matière de traitement, le Dr Steiger est formel : « le modèle coercitif ne fonctionne pas. Il n’y a aucune donnée probante pouvant suggérer que le fait de forcer une personne à prendre du poids quand elle n’est pas prête accélère l’issue du trouble alimentaire. »
Appuyée sur les données probantes et la transdisciplinarité, l’approche de Douglas vise à adopter une attitude résolument non autoritaire, décrit le chef du programme. Dans l’esprit de l’approche motivationnelle, les intervenants – ils sont une vingtaine – cherchent à mobiliser le désir autonome des patients au lieu de les contraindre. « On ne joue pas un rôle de police du poids; on aide les patients à explorer les croyances qui soustendent leurs décisions et à réévaluer leurs peurs. »
Ce que les cliniciens en première ligne peuvent faire « Tous les cliniciens peuvent devenir de bons intervenants pour les troubles alimentaires », insiste le spécialiste. Or, parce que ces troubles sont perçus – à juste titre – comme étant graves, cela génère une certaine anxiété chez les intervenants, observe-t-il. Mais il précise que c’est la minorité des patients qui est vraiment à risque. Selon lui, tous les cliniciens devraient connaître les principaux signes de danger : perte de poids rapide, débalancement électrolytique, bradycardie – le cœur qui bat trop lentement –, hypokaliémie, faiblesses ou pertes de conscience.
La collaboration avec le médecin généraliste est indispensable : « le psychologue doit établir un lien collaboratif avec le patient de sorte que la personne coopérera en allant consulter son médecin. » L’obtention du rapport médical permettra au clinicien de savoir si la personne est en situation de risque, « le tout étant fait dans la transparence sur ce qu’on fait et pourquoi on le fait », indique Howard Steiger. Les intervenants de Douglas offrent de la formation sur l’évaluation des risques et l’intervention initiale. Un résultat évident de ce transfert de connaissance vers la première ligne est la diminution de la très longue liste d’attente au programme de Douglas – un des premiers et des seuls centres spécialisés au Québec pour la clientèle adulte.
Reprendre contact
Typiquement, une patiente traitée à Douglas est d’abord suivie en externe et participe à des thérapies de groupe, des suivis individuels, des consultations nutritionnelles. En moyenne, près de 170 personnes sont suivies à la fois. Si cette étape ne fonctionne pas, l’hôpital de jour peut être envisagé : on y admet 15 personnes qui bénéficient d’un traitement plus intensif quatre jours par semaine. Les personnes préparent les repas et mangent ensemble. « Certaines n’ont pas cuisiné depuis 10 ans », illustre le Dr Steiger.
Au besoin, une unité interne de six places est disponible et le Dr Steiger espère pouvoir ajouter des lits pour mieux répondre au besoin. Il précise que son équipe et lui font tout leur possible pour éviter les hospitalisations involontaires. « Il y a des années qu’on ne l’a pas fait. On veut accueillir les gens quand ils sont prêts. »
Efficacité du traitement
De l’avis du Dr Steiger, la réponse au traitement dans le cas de la boulimie est définitivement bonne, et ce, même pour les traitements de courte durée. « Dans des suivis à long terme, 75 % des personnes sont complètement rétablies », ajoute-t-il. L’issue du traitement pour l’anorexie nerveuse est un peu moins favorable, quoique des études à long terme – par exemple sur 30 ans – semblent indiquer un portrait plus favorable. « Il faut du temps pour s’en sortir », résume le chercheur.
Les facteurs de réponse au traitement sont encore méconnus. « En général, 50 % des personnes anorexiques traitées auront un bon ajustement. La plupart demeurent préoccupées par l’image corporelle, mais vont mieux sur le plan du poids, de l’humeur et des relations. » Comme pour la toxicomanie, les périodes de retours de symptômes font partie du changement : 20 % des personnes hospitalisées pour anorexie feront une rechute dans les deux années suivantes, mais les récidives diminuent avec le nombre de rechutes, la personne développant chaque fois de nouvelles habiletés pour composer avec sa situation, explique le spécialiste.
Le Dr Steiger est fier de souligner que les résultats obtenus dans leur programme équivalent aux meilleurs résultats publiés dans la littérature. La triade « clinique-recherche-enseignement » mise de l’avant à Douglas n’y est, selon lui, pas étrangère. « Je ne me contente pas que nous ayons lu le plus récent textbook; je veux que nous soyons en train d’écrire le prochain! »
Et Internet dans tout ça?
Si le Dr Steiger apprécie le côté pratique des nouvelles technologies et d’Internet – dont un contact plus facile avec ses patients –, il est bien placé pour en percevoir les côtés nocifs. « On trouve des sites pro-ana qui encouragent les femmes à être de bonnes anorexiques en donnant des conseils sur comment ne pas manger, comment ne pas se laisser influencer, etc. »
Mais ces sites n’atteignent peut-être pas leur cible, note-t-il : « Peu après leur implication dans le traitement, la plupart des patientes ont un dégoût incroyable pour ces sites. Elles y voient l’expression du côté maladif des gens qui ont des troubles de l’alimentation et qui sont pris dans les grippes d’un système de pensée très puissant. »
Retenir son souffle
On entend souvent que l’anorexie est le produit de notre culte de la minceur, mais il semble que c’est plutôt la boulimie qui est en croissance dans les sociétés où cette pression est omniprésente, constate le Dr Steiger. Il note que l’anorexie existait de tout temps et qu’elle se manifeste dans toutes les régions du monde.
À ses yeux, les pertes de contrôle sur l’appétit ou encore l’alimentation compulsive liées à la boulimie sont des réponses « normales » à la restriction calorique excessive. « C’est comme retenir son souffle… jusqu’à devoir reprendre une grande inspiration dans l’urgence. » L’effet de la privation est clair : « moins manger provoque immédiatement une réduction dans l’activité sérotoninergique », soutient le Dr Steiger. Il suggère la prudence afin de ne pas surdiagnostiquer les personnes actives dans des troubles alimentaires, par exemple leur apposer une étiquette de dépression, de TOC, ou de troubles de personnalité, alors qu’en réalité les symptômes notés sont secondaires à l’altération importante de fonctionnement causée par la dénutrition.
Et attention, les antidépresseurs basés sur la recapture de la sérotonine fonctionneraient mal avec les personnes très dénutries : « difficile de recapturer ce qui n’est pas là… Le seul médicament dont la personne a toujours besoin, c’est la bouffe. »
L’autre « charte »
« Ce n’est pas le seul facteur, mais si on pouvait réduire les pressions socioculturelles vers la minceur, on réduirait l’incidence d’anorexie et de boulimie », affirme le spécialiste. Selon lui, il est impossible de développer un trouble alimentaire sans se soumettre à une restriction calorique : « un environnement qui favorise ce type de comportement va activer les vulnérabilités. »
En mars 2009, dans la foulée de démarches entreprises par des jeunes, un comité de travail mis sur pied par le gouvernement a eu le mandat de rédiger une charte d’engagement volontaire visant à promouvoir une image corporelle saine et diversifiée. Le Dr Steiger a été invité à y travailler. « Notre objectif était de rejoindre les gens influents dans les industries qui produisent des images dans les milieux de la mode, de la télé, etc. Nous avons formé un comité d’une trentaine de personnes et, sans être coercitifs, nous avons sollicité leur implication pour favoriser des conduites alimentaires sécuritaires. Comme conduire sans ceinture de sécurité, faire un régime est un comportement dangereux, et faire croire aux gens qu’ils devraient être plus maigres qu’ils le sont est très nocif. »
De ces travaux ont découlé des initiatives comme des engagements de certains magazines de mode, mais aussi d’autres projets, dont des ateliers de prévention destinés aux mannequins. « L’objectif n’est pas de rendre la minceur illégale, mais de laisser de l’espace pour la diversité », conclut le Dr Steiger.
Adresses utiles
- Le Programme des troubles de l’alimentation de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas offre des ateliers avec la possibilité de supervision continue aux professionnels du réseau de la santé du Québec.
- Anorexie et boulimie Québec (ANEB Québec)
- Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée