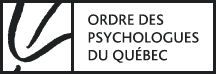Nathalie Plaat : s’inscrire dans le vivant
Anthony Bourgeault, psychologue et journaliste pigiste

Photo : Louis-Étienne Doré
Son départ du travail, le 28 janvier 2020, reste gravé dans sa mémoire : enfin décidée à affronter le mystère de la saillie qui transforme son sein, elle ferme les lumières de son cabinet de velours rouge pour rejoindre la clinique médicale. Cependant, en quittant la pièce intimiste, elle ne sait pas qu’elle part au combat, un combat pour sa vie. Bien qu’elle pressente la gravité de la situation, elle ignore encore l’acuité de la peur et des doutes qu’elle traversera avec hardiesse. Trépassera-t-elle? Et si elle reste vivante, abandonnera-t-elle la pratique de la psychothérapie pour laisser s’épanouir l’artiste qui croît en elle? Depuis ce jour charnière, sauvée par les avancées de la médecine et guidée par le caractère vital de l’intuition, la femme prendra presque deux ans avant de revenir se poser dans son fauteuil de psychologue, guérie et changée. Ardente malgré les nuages, cette femme s’appelle Nathalie Plaat. Selon leurs racines, le prénom latin « Nathalie » renvoie à l’expérience de la naissance, tandis que le nom germanique « Plaat » évoque une plage. Entretien avec une psychologue qui, à même son nom, porte à la fois deux langues, une allusion à la vie qui commence et un espace grand ouvert.
Vous oeuvrez à titre de psychologue, mais aussi en tant que chroniqueuse pour le journal Le Devoir, enseignante, autrice. Pour aller à la rencontre de votre identité plurielle, par où pourrait-on commencer?
Pour décider du programme universitaire dans lequel j’allais m’inscrire, j’ai lancé une pièce de monnaie : pile, la littérature, face, la psychologie. J’aime évoquer ce souvenir-là parce qu’il témoigne de mon intérêt envers les humanités depuis les débuts de ma démarche de pensée. Je me sentais attirée par la psychologie pour les mêmes raisons qui me poussaient vers la littérature : oui, pour aider, mais surtout pour comprendre les profondeurs et la complexité de l’être humain.
C’est peut-être ce qui me caractérise comme psychologue dans l’espace public : j’essaie de me tenir au centre d’une tension entre différents pôles, celui d’une discipline issue des sciences sociales, et celui de disciplines comme la philosophie, les arts, voire la théologie. Ainsi, je manie le langage savant de la psychologie, celui de l’empirisme et du positivisme. Mais aussi, avec une langue plus libre, je m’aventure dans des lieux existentiels qui n’ont pas besoin de données probantes pour se dire.
Dans l’espace des bureaux de consultation, les psychologues n’utilisent pas qu’un langage scientifique. Toute la relation thérapeutique nécessite d’être traitée avec une langue plus créative. Néanmoins, sur la place publique, j’entendais peu de psychologues qui prenaient la parole tout en déconstruisant la notion d’expert, c’est-à-dire en prenant le risque de tâtonner et d’adopter une posture de non-savoir. Être psychologue rigoureusement, ce n’est pas nécessairement donner des conseils.
Ce que vous dites évoque l’expression « juste psy » que vous utilisez pour vous décrire dans l’une de vos chroniques. À première lecture, la formulation étonne, compte tenu de l’étendue des champs que vous couvrez. En même temps, peut-on comprendre que, dans votre perspective, être « juste psy » implique d’occuper une place trouée vers le dehors, tendue vers l’autre?
J’aime cette manière de lire l’expression. L’idée du « juste psy » renvoie pour moi à l’humilité fondamentale de notre profession, une profession enchâssée dans quelque chose qui l’excède, dans un souci éthique de l’autre. Il s’agit d’une profession de l’ouverture. Évidemment, il y a un cadre avec des limites à respecter, mais si nous nous figeons dans certains protocoles, nous oublions une attitude essentielle à notre travail : la curiosité. Comme nous y invite la phénoménologie, je trouve extrêmement vivifiant d’aborder l’autre en essayant le plus possible de suspendre nos présupposés à son égard.
D’ailleurs, parce que l’élan de la curiosité le traverse, mon conte préféré est celui d’Alice au pays des merveilles : en suivant le lapin blanc, Alice arrive dans un monde d’une complète altérité, et elle l’explore. Ce conte nous enseigne qu’en prenant le risque de la rencontre, en portant attention à l’étrangeté de ce qui nous échappe, nous irons de découverte en découverte, éveillant heureusement notre imaginaire. À l’instar d’Alice, je suis intéressée par l’autre. Ce vif intérêt participe certainement à mon choix récent de m’engager dans un doctorat au Centre d’études du religieux contemporain.
Mais comment vous êtes-vous retrouvée dans ce département étranger?
D’une part, pendant que j’étais malade, j’ai touché la limite de mon existence. En jaquette bleue, sans cheveux ni sourcils, je n’étais plus Nathalie Plaat, psychologue. Je devenais un être humain expérimentant une vulnérabilité absolue. Je n’étais plus analysante étendue sur le divan de la psychanalyse, mais patiente avec des problèmes de santé graves, physiques. Ainsi, le contenant psychanalytique, celui à partir duquel je construisais mon univers de sens, m’est apparu étroit. Je me suis alors sentie interpellée par de nouveaux continents de pensée.
D’autre part, la maladie m’a mise en face d’un autre qui m’échappait radicalement, soit la figure du médecin. Bien que malade, je m’en faisais sincèrement pour mes soignants : je les trouvais souffrants, extrêmement compétents, mais souffrants. Je m’inquiétais de l’impact qu’avait sur eux le fait de perdre autant de patients et d’annoncer tant de mauvaises nouvelles au sein d’un réseau déshumanisé. Dans ce contexte, je constatais la présence d’un impensé : l’idée de la mort était totalement absente de tous les soins, alors que c’est pour la contrer que ceux-ci sont octroyés.
Avec curiosité, j’ai décidé de m’intéresser à cet intrigant corps médical jusque dans l’élaboration d’un projet de thèse. Pour l’instant, ce projet consiste à réfléchir à l’évacuation des humanités médicales dans la formation des médecins en tant que source de souffrance éthique pour eux. Le Québec fait d’ailleurs figure d’exception dans ce domaine : le paradigme techno-scientifique monopolise le cursus partout, mais ici il le fait d’une manière qui évacue encore davantage les savoirs issus des humanités. On dirait que le système actuel ne donne pas droit d’exister à certaines parts de soi, plus spirituelles, contraignant ainsi les professionnels de la santé à lâcher une possibilité de tension. Je dénonce cette tendance y compris au sein de notre profession.
Vous insistez sur l’importance de la tension. En vous lisant, on est justement saisi par votre capacité à rassembler des attitudes et des mouvements antagonistes : la digression et la direction, la méditation et l’interpellation, l’hospitalité et la colère, la parole du singulier et celle d’un « nous »… Dans la mesure où vous avez dû faire face au danger de la mort, n’est-ce pas toute une bravade que vous lui faites en embrassant aussi largement la vie?
Nous accompagnons les gens vers l’horizon de la complexité. Nous les aidons à grandir, voire à s ’agrandir, à cesser de nier des parts d’eux-mêmes pour mieux relever l’aventure de la vie. Certainement, aller à contre-courant d’une tendance visant à nous réduire nécessite d’abord un travail sur soi.
Pour le temps qu’il me reste, est-ce que je peux demeurer vivante jusqu’à la fin? Je me réfère ici au dernier ouvrage de Paul Ricoeur, Vivant jusqu’à la mort. Me revient également la formule de Paul Tillich, « avoir le courage d’être ». Ainsi, puis-je avoir le courage de mes pensées, qui ne sont pas des dogmes?
Si je lutte contre une chose, c’est contre la rigidité, cette force mortifère qui contraint à éviter l’angoisse issue du contact avec la pulsion. L’indocilité face aux manifestations dogmatiques de l’autorité coule d’ailleurs dans mes veines. Comme je suis d'ascendance européenne, mes grands-parents sont marqués par les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Non seulement mon grand-père hollandais a survécu à son exploitation en camp de travail, mais mes grands-parents français faisaient partie de la Résistance. Par leurs actes de révolte contre l’occupation allemande, ceux-ci ont agi à la manière d’Antigone, une figure si importante pour moi.
Personnellement, à une autre échelle, j’espère mener mes combats avec une radicalité douce, aimante. Avec la maturité, je persiste à croire qu’on a collectivement besoin d’une part de punk pour nous dégager de la rigidité réductrice s’immisçant dans nos discours professionnels. Il me semble également que l’autorité revêt aujourd’hui des visages trompeusement séduisants, avec tous ces guides de la parentalité, par exemple, qui génèrent de la pression chez de nombreux parents. Peut-on plutôt faire confiance à un instinct et risquer l’authenticité?
En terminant, un clin d’oeil à l’infini : vous arrive-t-il de jouer avec la notion d’immortalité? Vos réflexions, incarnées dans votre expérience, conversent avec des dimensions existentielles, y compris avec la finitude. Sur une même pièce, à l’envers du réel de la mort, pourrait-on apercevoir quelque chose comme un souhait d’immortalité?
Je n’y avais pas pensé comme ça. Par ailleurs, depuis que j’ai failli mourir, il est vrai que je m’active beaucoup à laisser une trace. Est-ce une façon de déjouer ma mortalité?
Je me rappelle un épisode insoutenable, alors que j’étais en traitement, toujours incertaine de ma survie. Je classais des photos enregistrées sur un disque dur. Par accident, elles ont disparu. Que mon conjoint ait ensuite récupéré les images n’a pas suffi à calmer l’angoisse fulgurante qui m’envahissait : c’était moi que j’avais cru effacer. À l’époque, ma fille avait trois ans, et j’avais craint de ne plus exister en image dans sa mémoire ; j’avais craint que, privée de la bande photographique lui montrant sa mère, elle m’oublie si je décédais.
Je me rends compte de ma rage à être inscrite dans le vivant. Je n’ai jamais eu autant à dire, à écrire, et je le transmets. Ce sera ma trace, une trace en mouvement : je mets ma pensée en marche, celle-ci cogne légèrement sur la pensée de ceux qui m’écoutent, qui me lisent, et cette pensée, la leur, poursuit l’élan. Quelque chose de moi existe en l’autre.
Je vais mourir. Les personnes que j’aime mourront aussi. Avant de rencontrer ma finitude, je n’avais pas réalisé combien je me leurrais dans une illusion d’infinitude. Nous mourrons, je le sais maintenant. C’est un saisissement duquel on ne se remet pas, et j’ai envie d’ajouter : heureusement.
À traits levés
1. Un livre marquant.
Les tranchées, de Fanny Britt
2. Un film émouvant.
The Tree of Life, de Terrence Malick
3. Une figure inspirante.
Paul Ricoeur
4. Un conseil à la jeune Nathalie.
« Ose être toutes les femmes que tu es. »
5. Un conseil aux jeunes psychologues.
« Tu ne sais rien. Et ce n'est pas grave. »