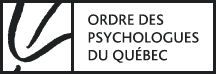Marie Leclaire, ou le pari de l'espérance
François Van Hoenacker, rédacteur en chef

Photo : Louis-Étienne Doré
Solidement ancré dans le réel, l’optimisme de Marie Leclaire ne repose ni sur une réalité édulcorée, ni encore sur le déni. L’espoir en l’humanité qu’elle entretient semble aujourd’hui presque relever d’un acte de résistance (ou peut-être du tabou?). Cultivant une posture de réflexivité, une curiosité manifeste et une quête constante d’idées novatrices, elle ne se contente pas que de parler de cette démarche : elle l’applique dans son travail, dans sa vie quotidienne… et même dans cet entretien. Sortant du format habituel d’une entrevue, elle demandera à maintes reprises l’avis de son intervieweur, rebondira sur ses réponses pour mieux revenir à la charge avec de nouvelles réflexions. Ayant déjà connu une riche carrière, la clinicienne est professeure adjointe de clinique du Département de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) et oeuvre à la Clinique de médecine familiale Notre-Dame, à Montréal. Superviseure et formatrice, elle collabore aussi activement avec le Bureau du patient partenaire de la Faculté de médecine de l‘UdeM. En plus de son impressionnant parcours, la psychologue se démarque aussi par cette vaste confiance qu’elle entretient dans la capacité de transformation et de guérison, et ce, autant sur le plan individuel que collectif. Rencontre avec la Dre Marie Leclaire, psychologue, qui devant la vie fait le pari d’un beau risque : celui de l’espérance.
Dans vos formations et vos écrits, on a tôt fait de constater votre intérêt marqué pour l’histoire, la sociologie, la philosophie, la littérature et les arts. Comment en êtes-vous venue à choisir la profession de psychologue plus particulièrement?
Ce qui me passionnait le plus, c’était de plonger dans l’expérience, la complexité, la profondeur, je dirais, de l’âme humaine. L’être humain n’est pas fait que de belles choses, notre histoire et les conflits mondiaux nous le rappellent chaque jour. Il y a en l’humain un côté pulsionnel, un côté sombre, une violence… mais il y a aussi une possibilité de réparation et de sublimation. Cette espèce de tension entre la lumière et la noirceur en chaque être humain m’a toujours fascinée, et elle continue aujourd’hui d’éveiller ma curiosité. Cette curiosité m’est d’ailleurs très précieuse en psychologie, m’incitant à aller au-delà des premières impressions, à envisager de nouveaux possibles.
Vos différents milieux de travail ont-ils contribué à satisfaire cette curiosité?
En psychologie, on développe des savoirs et des expertises sur la réalité psychique et relationnelle, sur sa complexité. Mais dans une relation de soin, personne n’est jamais l’expert de l’autre. Dans tous ces environnements, j’apprends énormément en côtoyant des médecins de famille, des résidents en médecine, divers professionnels de la santé, d’autres psychologues. Cette pluralité de regards m’aide à avoir une vision beaucoup plus large de ce que veut dire soigner, et m’aide à rester attentive à ce qui peut favoriser, mais aussi détruire le soin dans une relation. Avec le Bureau du patient partenaire, j’ai la chance de travailler en équipe sur des projets pédagogiques novateurs avec des patients qui ont des savoirs expérientiels à la fois de la maladie et du système de santé. Les patients partenaires nous aident à déceler nos angles morts, à nous rappeler que le soin doit demeurer en création et en coconstruction.
Et pourquoi avoir choisi l’approche psychodynamique?
C’était l’approche qui, à mes yeux de jeune psychologue, permettait le mieux de répondre aux mystères de la psyché. D’accéder aux contenus inconscients qui font énigme, à notre bagage pulsionnel, aux mémoires dont nous sommes porteurs.
La méthode psychanalytique, c’est aussi pour moi une entreprise de désaliénation, qui permet d’être plus en contact avec ce qui se répète souvent à notre insu. Elle invite à une posture d’humilité et de non-savoir, qui selon moi est primordiale pour aller à la rencontre de l’autre.
Mais pour moi, ce n’est pas la fidélité envers l’approche qui compte : c’est la fidélité envers le réel. Je me nourris aussi des autres approches et des humanités dans mon travail de psychologue et d’enseignante. Il m’est important de remettre les théories et les concepts en circulation, en question. On ne pourra pas répondre éternellement aux questions du monde d’aujourd’hui avec les réponses formulées à une autre époque.
En plus d’inviter à la réflexivité, la psychanalyse nous permet aussi de nous intéresser à notre rapport à la collectivité.
Dans la revue Liberté, vous écriviez d’ailleurs qu’il fallait cesser d’évacuer au Québec la dimension politique et sociale de la maladie mentale…
Dans ce texte, je constatais à quel point les sociétés québécoises et tunisiennes avaient réagi différemment aux suicides de deux jeunes hommes issus de leur communauté respective. Ces deux drames étaient présentés côte à côte dans Le Devoir, sans qu’aucun lien ne soit établi entre eux.
En Tunisie, la population pouvait s’identifier à l’injustice, à la rage, à la souffrance qui avait pu pousser Mohamed Bouazizi à s’immoler, événement lié au début du printemps arabe.
Chez nous, outre la maladie mentale, le papier sur le suicide du jeune Québécois évacuait tout contexte social, tout événement ayant pu mener le jeune homme au désespoir. Qu’avait-il vécu, qu’avait-il subi pour se rendre jusqu’à commettre l’irréparable?
Au Québec, les carences, les injustices, les abus, les rapports arbitraires de pouvoir semblent trop souvent évacués du discours en santé mentale. On s’attarde à la capacité individuelle de chacun à s’adapter au monde tel qu’il est. Sans s’en rendre compte, on se prive ainsi de la créativité politique des citoyens, de la satisfaction liée au fait de contribuer à un monde meilleur et plus juste.
Le bureau du psychologue offre-t-il un espace où peuvent justement se penser et se dire cette souffrance, ses causes, ses origines?
Oui, et c’est pourquoi il faut protéger ces espaces de parole et faire en sorte qu’ils deviennent accessibles au plus grand nombre. En thérapie, il est primordial d’ouvrir notre champ attentionnel, d’aller au-delà des premières explications. D’offrir au patient un lieu où peuvent se nommer ses enjeux, sa peine, les choses « moins belles » qui l’habitent. Bien souvent, c’est du côté de ce qui est le plus gênant, de ce qui n’a jamais pu se dire — voire même se penser — qu’on peut découvrir ce qui nous influence le plus.
Et autant ces espaces sont précieux, autant la responsabilité du psychologue est grande...
Pour moi, il y a vraiment une responsabilité, une tâche éthique double pour le psychologue : expliciter le cadre de la thérapie tout en laissant le temps de vivre et de ressentir ce qu’on y fait, ce qui s’y dépose, afin d’obtenir un consentement qui soit réellement libre et éclairé. De prendre le temps de se demander, avec le patient : qu’est-ce qu’on fait, dans quoi on s’embarque? Le psychologue doit s’efforcer d’être digne, en quelque sorte, du soin.
Vous évoquiez plus tôt la capacité de transformation chez l’être humain. Nos collectivités sont-elles à votre avis dotées de cette même capacité?
Je ne ferme pas les yeux sur ce qui se passe, je n’ai pas des lunettes roses. Pour faire des grands changements comme ceux requis à notre époque, cela prendra des renoncements, de grandes remises en question. Il faudra se dégager d’une indéniable « servitude volontaire », où l'on délaisse sa liberté pour servir d'autres intérêts. Le fait de me nourrir de l’histoire, de philosophie, des arts me permet d’entrer en relation avec tout plein d’humains et de collectivités qui, à différentes époques, sont parvenus à penser autrement, avec créativité et courage, à se mobiliser. Je vois beaucoup d’engagement et de volonté chez les patients partenaires avec qui je collabore pour changer le paysage de soins en santé, le démocratiser et l’humaniser. Un peu comme en thérapie, une joie peut découler du fait de contribuer à la société, de se sentir plus libre, plus responsable, et surtout quand cette mobilisation est partagée.
J’aime mieux faire le pari du courage, de continuer à croire qu’on peut s’en sortir, qu’on peut faire les choses différemment. Je demeure optimiste parce que, devant les défis, on n’arrêtera pas les têtes de penser. Je vois de la bonté chez l’être humain, j’en ai toujours vu, et je continue d’en voir dans les moments les plus difficiles.
Et je garde espoir, parce qu’on n’empêchera jamais les coeurs d’aimer.
À traits levés
1. Un livre marquant.
Psychologie des foules et analyse du moi, de Freud
2. Un film émouvant.
24 heures ou plus, de Gilles Groulx
3. Une figure inspirante.
Le psychiatre martiniquais Frantz Fanon
4. Une œuvre touchante.
Rome, de Jean Marc Dalpé et Brigitte Haentjens
5. Un conseil aux jeunes psychologues.
D’avoir confiance en l’écoute, de continuer à la cultiver.