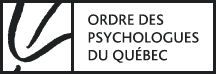La détection de faux souvenirs

Retraité après 36 ans de professorat à l’Université de Montréal, le Dr Van Gijseghem œuvre en expertise psycholégale dans diverses juridictions. En 2014, pour souligner le caractère exceptionnel de sa carrière, l’Ordre des psychologues du Québec lui décernait le prix Noël-Mailloux.
Il fut un temps où, au cours d’une thérapie, les cliniciens étaient fort impressionnés par l’émergence, chez un client donné, de souvenirs qui, à la longue, atteignaient une telle élaboration que celui-ci devenait convaincu d’avoir été victime d’abus dans le passé. La plupart de ces clients prétendaient n’avoir jamais eu de tels souvenirs auparavant et le clinicien avait tôt fait d’y reconnaître une compatibilité frappante avec la théorie du refoulement et du « retour du refoulé » ou avec celle de l’amnésie traumatique. Dans un des textes fondateurs sur le refoulement, Freud (1961/1907) avait utilisé la métaphore « Pompéi » pour expliquer le mécanisme d’un tel retour du refoulé : il avait suffi de balayer les cendres du Vésuve pour découvrir à peu près intacte la ville jadis enfouie. Cette métaphore fait référence à une théorie de la mémoire qui tient celle-ci pour une faculté reproductive : l’individu aurait vécu un événement dont le souvenir, pour une raison ou une autre, aurait été enfoui, couvert, « refoulé » tout en demeurant quelque part intact comme il en fut de Pompéi. Il suffirait qu’un beau jour quelque chose réveille le souvenir latent ou qu’un thérapeute, muni de sa brosse « archéologique », permette de retrouver l’événement original. Cette hypothèse a donné lieu au mouvement des « souvenirs retrouvés », dont les « théoriciens de la trace » se sont emparés (par exemple, Terr, 1994). Ils y voyaient de nouvelles confirmations des propositions théoriques des associationnistes tels que Hobbes et Locke ou encore des interprétations que Hebb et Penfield avaient données à certains résultats de leurs expériences scientifiques dans le domaine de la physiologie du cerveau (interprétations qui ont été infirmées par la suite).
Une nouvelle pratique thérapeutique prit ainsi naissance, dont l’objet visait à retracer des événements enfouis pour finalement « retrouver » le souvenir. À l’époque du vaste dévoilement des abus sexuels (1979-1980), les tribunaux ont eu à traiter pendant au moins deux décennies des causes d’abus dont souvent la seule preuve résidait dans les souvenirs retrouvés. Un courant contraire allait cependant changer les choses quand les chercheurs se sont davantage penchés sur l’étude de la mémoire. Appuyés sur les déjà anciens travaux de Bartlett (1932) et de Neisser (1967), ils opposèrent à la théorie de la mémoire reproductive celle de la mémoire reconstructrice. Plutôt que de recourir à un présumé refoulement pour expliquer la disparition d’un souvenir, ils invoquaient plutôt l’oubli ou la répression. À partir de leurs recherches en laboratoire et sur le terrain, le fait de retrouver un souvenir n’allait plus être considéré comme l’extraction d’un lointain original, tel qu’une vidéo ou une photographie enterrée depuis longtemps et qui réapparaîtrait intégralement. Les résultats de ces recherches montraient plutôt que, même retranché dans le « maquis », le souvenir subit d’importantes modifications et, une fois retrouvé, il revêt des aspects qui correspondent davantage aux besoins actuels du sujet qu’aux éléments factuels d’un événement passé.
Les travaux de Loftus, résumés dans son livre phare de 1994, allaient ajouter un cran à cette nouvelle conception du souvenir : la reconstruction n’émerge pas nécessairement d’une ancienne expérience réellement vécue. Le souvenir soi-disant retrouvé peut très bien être une construction tout court, c’est-à-dire être involontairement construit de toutes pièces pour répondre aux besoins actuels du sujet. Ainsi, Loftus, à l’aide de techniques et d’autres manipulations suggestives, réussissait à implanter de faux souvenirs, c’est-à-dire aucunement basés sur des faits réellement vécus et dont les sujets finissaient pourtant par affirmer avec force la véracité (Loftus et Ketcham, 1994).
Les tenants des deux écoles de pensée se sont dès lors livrés à des batailles épiques, aussi bien dans les revues savantes que devant les tribunaux. Les défenseurs de la théorie de l’extraction des souvenirs avaient beau s’en référer à la théorie freudienne, ils n’en occultaient pas moins certains écrits notoires du père de la psychanalyse lui-même. Dans un de ses derniers textes (1961/1937), celui-ci avait en effet pressenti l’utilité pour certains patients d’élaborer, au fil des interprétations, des souvenirs sans fondement réel. On ne s’étonnera pas du fait que Freud ait intitulé ce texte « Constructions dans l’analyse ».
La controverse n’a toujours pas pris fin, d’ailleurs (Belli, 2012). Les experts en matière d’accusations d’abus sexuel rencontrent souvent de présumées victimes qui prétendent avoir retrouvé leurs souvenirs au cours d’une lecture, du visionnement d’un film, d’un rêve, d’un exercice d’imagerie mentale, d’une séance d’hypnose ou d’une thérapie. Ces sujets rapportent que leur thérapeute, tenant leurs souvenirs pour vrais, les auraient même encouragés à porter plainte. Un matériel narratif émanant d’une démarche psychothérapique se transporte ainsi sur la place publique sous forme d’une dénonciation, d’une plainte aux policiers ou d’un recours civil. Vis-à-vis de cette problématique, les chercheurs du courant contradicteur soulignent l’importance de bien distinguer entre une réalité psychologique ou narrative (celle rencontrée en psychothérapie) et la réalité factuelle ou historique (celle à laquelle s’intéresse la justice). (Lynn et coll., 2015; McNally, 2003).
Depuis une quinzaine d’années, une autre ligne de recherche a créé des remous supplémentaires quant à certaines idées reçues. La théorie du refoulement est basée sur l’idée que certains événements sont trop difficiles à gérer sur le plan psychologique et que leur souvenir sera donc enfoui dans un quelconque « inconscient ». L’émoi qui y était associé survivrait, de façon non liée à son contenu initial, sous la forme d’angoisse « sans nom ». Or, les recherches sur la mémoire autobiographique, de façon consistante, ont livré des résultats qui contredisent cette vision : en général les souvenirs d’événements difficiles sont beaucoup mieux préservés que ceux des moments heureux (McHugh, 2008; McNally, 2003, 2007).
Riche de ces données, on peut dire qu’il est très rare qu’un sujet efface le souvenir d’un événement traumatique vécu dans son enfance, et ce, aussi tôt qu’à 3 ou 4 ans (Lynn et coll., 2015; McNally, 2003).
Les données probantes devraient donc inciter le clinicien à une extrême prudence lorsqu’un client prétend retrouver un souvenir d’abus dont il n’aurait pas auparavant été conscient. Pour de multiples raisons possibles, ce client pourrait bien être en train de construire involontairement un soi-disant souvenir qui n’a aucun lien avec des faits réels. Par exemple, un sujet aux prises avec une angoisse incompréhensible pourrait justement en chercher la raison dans son passé nébuleux, croyant illusoirement trouver la paix en cernant sa source. Dans de telles circonstances, tout sujet se trouve extrêmement vulnérable à la suggestion, surtout quand elle émane d’une personne investie d’un pouvoir ou d’un profond savoir. Pour peu que le thérapeute, de façon verbale ou non, valide telle construction d’un passé traumatique, le sujet risque d’y accrocher solidement. Aussi longtemps que la construction ne déborde pas l’intersubjectivité de l’alliance thérapeutique, les conséquences restent possiblement limitées. Mais quand le thérapeute encourage la transposition de cette construction dans l’espace public, on peut assister à des dérapages qui risquent de chambouler la vie de plusieurs personnes, tout en créant une victime là où il n’y en avait pas nécessairement une auparavant.
Bien sûr, dans le cadre d’une relation psychothérapeutique, on ne doit guère évacuer la réalité subjective, psychologique ou narrative. Celle-ci demeure déterminante pour le sujet et c’est donc la réalité avec laquelle le thérapeute aura à travailler, d’autant plus que celle-ci, pour le client, prend le pas sur la réalité objective ou factuelle. Cela est d’ailleurs vrai dans plus d’une approche théorique. Il importe toutefois de ne pas confondre les deux réalités.
On comptait entre 65 et 75 % des cliniciens croyant en l’utilité des techniques de recouvrement des présumés souvenirs et en leurs bienfaits subséquents (Poole, 1985 ) et ces chiffres inquiétants ne semblent pas avoir diminué après presque 25 cinq ans de pratique douteuse (Legault et Laurence, 2007). En plus, un grand nombre de ces cliniciens pensent que le souvenir a des chances d’être « vrai » s’il est accompagné de l’émotion appropriée, alors que la recherche a clairement démontré que l’évocation d’un faux souvenir suscite souvent plus d’émotion que la narration d’un vrai souvenir (Krackow, 2010). Pour distinguer le vrai du faux, on ne peut pas davantage compter sur la présence de réactions psychophysiologiques, puisque celles-ci sont à peu près identiques dans les deux cas (par exemple, Krackow et Rabenhorst, 2010; McNally et coll., 2004). On ne peut pas davantage se fier à quelque trouble de stress post-traumatique pour déclarer vrai un souvenir, car les réactions post-traumatiques se révèlent aussi intenses chez un individu qui croit faussement avoir vécu un traumatisme que chez celui qui l’a réellement vécu (McNally, 2003; McNally et coll., 2004).
Conclusions
Tout clinicien devrait douter de la validité d’un souvenir retrouvé quand son client en a jusque-là ignoré l’existence. Cela vaut particulièrement quand le soi-disant souvenir apparaît à la suite de certaines techniques thérapeutiques ou autres, ce qui est le cas le plus souvent. Concernant l’occurrence passée d’événements difficiles, ni la théorie du refoulement ni celle de l’amnésie traumatique n’ont été validées par la recherche scientifique et elles ne peuvent donc pas être invoquées pour donner une base heuristique fiable au souvenir « retrouvé ».
La recherche démontre plutôt qu’une expérience traumatique, même vécue à l’âge de 3 ou 4 ans, est rarement occultée par la mémoire. Le fait qu’un sujet n’ait jamais perdu le souvenir de l’événement indique par conséquent la probabilité de son occurrence réelle.
Certains indicateurs traditionnels pour évaluer la crédibilité ou la véracité d’un récit n’ont pas davantage survécu au test de la vérification scientifique : par exemple, la présence d’une émotion appropriée, certaines réactions psychophysiologiques ou encore la présence de symptômes post-traumatiques. Ces « indicateurs » sont présents aussi bien quand il s’agit d’un souvenir vrai que lorsque le souvenir est faux, mais que le sujet croit en sa véracité.
Bibliographie
- Bartlett, F. (1932). Remembering: A study in experimental and social psychology. Cambridge : Cambridge University Press.
- Belli, R. (dir.) (2012). True and False Recovered Memories. Toward a Reconciliation of The Debate. New York: Springer.
- Freud, S. (1961). Delusions and dreams in Jensen’s Gradiva. Dans J. Strachey (dir. et trad.). The Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol. 9, p. 3-95). London : Hogarth Press (originalement publié en 1907).
- Freud, S. (1961). Constructions in analysis. Dans J. Strachey (dir. et trad.). The Standard Edition of The Complete Psychological Works of Sigmund Freud (vol. 23, p. 257-269). London : Hogarth Press (originalement publié en 1938).
- Krackow, E. (2010). Narratives distinguish experienced from imagined childhood events. American Journal of Psychology, 123, 101-117.
- Krackow, E., et Rabenhorst, M. (2010). Does the body know best? Psychophysiological reactivity to perceived versus imagined childhood events. Imagination, Cognition and Personality, 30, 133-145.
- Legault, E., et Laurence, J. R. (2007). Recalled memories of child sexual abuse: Social work, psychology and psychiatric reports of beliefs, practices and cases. Australian Journal of Experimental and Clinical Hypnosis, 35, 111-133.
- Loftus, E., et Ketcham, K. (1994) The Myth of Repressed Memories, New York : Plenum.
- Lynn, S., Krackow, E., Loftus, E., Locke, T., et Lilienfeld, S. (2015). Constructing the past. Problematic memory recovery techniques in psychotherapy. Dans S. Lilienfeld, S. Lynn et J. Lohr (dir.) Science And Pseudoscience In Clinical Psychology (2e édition, p. 210-244). New York : Guilford.
- McNally, R. (2003). Remembering Trauma. Cambridge : Harvard University Press.
- McNally, R. (2007). Betrayal trauma theory: A critical appraisal. Memory, 15, 280-294.
- McNally, R., Lasko, N., Claney, S., Macklin, M., Pitman, R., et Orr, S. (2004). Psychophysiological responding during script-driven imagery in people reporting abduction by space aliens. Psychological Science, 13, 493-497.
- McHugh, P. (2008). Try To Remember: Psychiatry’s Clash Over Meaning Memory And Mind. New York : Dana Press.
- Neisser, U. (1967). Cognitive Psychology. New York : Appleton-Century-Crofts.
- Poole, D., Lindsay, D., Memon, A., et Bull, R. (1995). Psychotherapy and the recovery of memories of childhood sexual abuse: U.S. and British practitioners opinions, practices and experience. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 426-437.
- Terr, L.(1994). Unchained Memories. New York: Basic Books.