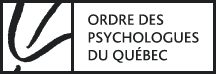Psychologie et milieu de l’éducation : le poids des dilemmes éthiques

Au moment d'écrire cet article, la Dre Rodrigue oeuvrait comme neuropsychologue au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin. Elle travaille maintenant comme neuropsychologue pour le compte de Retraite Québec. Elle s’intéresse au déploiement des connaissances issues de la neuropsychologie pédiatrique dans un contexte d’approche RAI (« réponse à l’intervention »).

Mme Landry oeuvre comme psychologue depuis plus de 30 ans. Elle partage sa passion entre la pratique privée et le monde de l’éducation.
À la fois stimulant et varié, le milieu de l’éducation est tout indiqué pour tout psychologue qui désire relever des défis. Dans cet article, nous présentons une courte réflexion portant sur les stresseurs rencontrés par le psychologue scolaire. Un thème nous apparaît central : le défi de satisfaire l’ensemble des attentes des multiples intervenants et clients, tout en respectant les obligations professionnelles et les limites personnelles. Loin d’être futile, cette réalité peut devenir envahissante si la vigilance du psychologue faiblit, ou s’il n’est pas soutenu par un milieu bienveillant.
Concilier les obligations déontologiques vis-à-vis des clients et le rôle attendu d’un psychologue œuvrant en milieu scolaire constitue un défi majeur. À propos de la notion de client, Michon (2020) mentionne ceci : « Le Centre de services scolaires est à la fois le client employeur et le client demandeur et il délègue aux directions la gestion et l’attribution des mandats. L’élève est pour sa part le client objet de services. » En parallèle, l’approche RAI (axée sur la prévention et l’intervention précoces) est retenue par plusieurs centres de services scolaires au Québec. Ainsi, le psychologue effectue non seulement des évaluations et des interventions individuelles, mais il assure aussi une prestation de service concernant des activités de dépistage, de prévention, de soutien au milieu, etc. Conséquemment, le fait de considérer l’élève comme étant l’unique client objet de services est une conception difficilement réconciliable avec la pratique.
Le rôle du psychologue ne se résume pas à assurer le bien-être d’un seul élève, mais bien à veiller aux intérêts de l’ensemble des élèves des écoles qui lui ont été attribuées par l’employeur, ainsi qu’à soutenir les parents et les membres du personnel qui gravitent autour d’eux. Or, les intérêts des uns ne sont pas toujours compatibles avec les intérêts des autres. Dans ce contexte d’intervention systémique, les dilemmes éthiques sont omniprésents. Par exemple, en contexte pandémique, comment conjuguer l’enseignant anxieux d’être contaminé et un enfant qui éprouve des difficultés à suivre les consignes sanitaires? Et en contexte d’école inclusive, considérant la pénurie de services, comment et qui prioriser? Notre élève intimidé? En deuil? En crise? Dépressif? Suicidaire? En contexte de classe, comment arrimer les intérêts de notre élève qui se désorganise, ceux de nos deux élèves TSA qui en sont affectés et ceux de l’équipe-école en détresse?
Fréquemment, le psychologue apprend des informations de manière totalement fortuite (par exemple, pendant le dîner au salon du personnel), ce qui le place dans d’inconfortables postures. Houde (2018) et Lorquet (2018, 2019), dans leur chronique respective, font d’ailleurs brillamment état de défis déontologiques pour les psychologues scolaires. Mentionnons aussi la position de vulnérabilité dans laquelle le psychologue se trouve lorsque la situation requiert de mettre fin aux services dans un contexte de secret professionnel. Sans la pleine confiance de l’employeur, le psychologue peut se trouver pris dans un étau.
Paradoxalement, alors qu’il devrait prendre du recul, s’appliquer à gérer son stress et prendre davantage soin de lui-même, le psychologue choisit souvent comme stratégie adaptative d’en faire plus. Or, il s’agit d’un véritable cercle vicieux et le psychologue risque de s’enliser vers un état d’épuisement professionnel ou de fatigue de compassion. Fragilisé, il n’est pas non plus à l’abri de faire des erreurs (cf. Vachon, 2016).
Devant cette réalité, il est crucial que le psychologue prenne les dispositions nécessaires afin de ne pas se laisser entraîner dans la spirale infernale du stress et de demeurer connecté à l’essence même qui a motivé son choix de carrière, soit le désir d’apporter une aide entière et bienveillante aux enfants. Nous tenons également à rassurer le psychologue en début de carrière : il est tout à fait possible pour un psychologue de mener une carrière satisfaisante dans le monde de l’éducation. Si la culture organisationnelle de certains milieux est peu compatible avec le sain exercice de nos fonctions, d’autres se distinguent par leur savoir-être et leur appui auprès des professionnels.
Bibliographie
- Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires francophones (2015). Plan de classification – Personnel professionnel des commissions scolaires francophones.
- Gouvernement du Québec. Code de déontologie des psychologues. L.R.Q., chapitre C-26, r-212.
- Houde, D. (2016). Mettre un terme à ses services avec professionnalisme. Psychologie Québec.
- Houde, D. (2018). À propos des défis qu’ont à relever les psychologues scolaires. Psychologie Québec.
- Goguen, S. et Montreuil, Tina C. (2016). La psychologie scolaire au Québec. Canadian Journal of School Psychology, 31(3), 219-234.
- Lorquet, É. (2019a). Milieu scolaire : le partage d’informations cliniques entre les membres d’ordres professionnels. Psychologie Québec.
- Lorquet, É. (2019b). Secret professionnel et dossiers professionnels dans les écoles : des clarifications. Psychologie Québec.
- Michon, É. (2018). Les obligations déontologiques du psychologue en milieu scolaire (formation en ligne). Ordre des psychologues du Québec.
- Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. (2021). Politique de la réussite éducative.
- Pednault, F. (2015). Le rôle du psychologue scolaire dans une démarche RAI : relier l’évaluation à l’intervention. Bulletin de liaison de l’AQPS, 27(3), 17-23.
- Rodrigue, L. (2021, 19 avril). RAI. Modèle de réponse à l’intervention. 1001 Neurones en action.
- Vallières, P., Dubois, M. et Desroches, A. (2018, septembre). La contribution de la psychologie scolaire à la mise en œuvre du modèle de réponse à l’intervention. Psychologie Québec.
- Vachon, R. (2016). Six facteurs de risque d’un dérapage déontologique. Psychologie Québec.