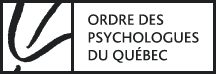La surexposition aux images idéalisées dans les médias sociaux et l’émergence d'attitudes et de comportements alimentaires dysfonctionnels

Titulaire d’un doctorat en psychologie, clinicienne et chargée de cours au Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), la Dre Ménard est co-gestionnaire du groupe de recherche transdiciplinaire Loricorps de l'UQTR. Elle est également affiliée au Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (CR-IUSMM).

Titulaire d’un doctorat en cotutelle franco-québécois en sciences du mouvement humain et Education-psychoéducation, Mme Monthuy-Blanc est professeure au Département des sciences de l'éducation de l’UQTR, responsable de l’Unité de recherche transdisciplinaire Loricorps de l'UQTR et chercheure régulière au CR-IUSMM.

Titulaire d’un doctorat en psychologie, Mme Corno est chercheure d’établissement au CISSS de l'Outaouais, professeure associée au département de psychoéducation et de psychologie de l’UQO et chercheure de l’Unité de recherche transdisciplinaire Loricorps de l'UQTR.

Titulaire d’un doctorat en sciences biomédicales, Mme Saint-Pierre est professeure au Département d'ergothérapie de l’UQTR et membre de l’Unité de recherche transdisciplinaire Loricorps de l'UQTR, affiliée au CR-IUSMM.

Étudiante à l'UQTR, au doctorat en neuropsychologie, profil intervention et recherche, Mme Tournayre est également membre de l’Unité de recherche transdisciplinaire Loricorps de l'UQTR et affiliée au CR-IUSMM.
Selon une enquête canadienne sur l’utilisation d’Internet, près de 90 % de la population des 15-34 ans, 80 % des 35-49 ans et 60 % des 50-64 ans utilisent fréquemment les médias sociaux (Schimmele et al., 2021). Ces plateformes sont des moyens de communication omniprésents exerçant une influence sur la manière de percevoir notre corps. Cet article documente l'influence de ces médias sur l’image corporelle ainsi que sur les attitudes et comportements alimentaires (ACA) dysfonctionnels.
Les médias sociaux et l’image corporelle
Dans la littérature scientifique, les médias sociaux sont associés à des effets négatifs sur l’image corporelle (Saiphoo et Vahedi, 2019), principalement nos perceptions (ex. : la représentation mentale de la taille et de la forme corporelles) et nos attitudes (ex. : nos sentiments, notre cognition et nos comportements) vis-à-vis de notre apparence physique (Cash, 2012). La majeure partie de ces effets négatifs est attribuable à la diffusion prédominante de contenus promouvant des idéaux de minceur et de tonus (personnes à dominante féminine), ainsi que de minceur et de musculature (personnes à dominante masculine) (Saiphoo et Vahedi, 2019).
Les images, en véhiculant des normes corporelles irréalistes, activent deux mécanismes, soit la comparaison sociale et l’auto-objectivation, contribuant au développement de perturbations liées à l’image corporelle (Rodgers et al., 2021).
Internalisation des idéaux de beauté, comparaison sociale et auto-objectivation
Les théories socioculturelles soulignent le rôle des pressions médiatiques à l’égard des idéaux de beauté (Rodgers et al., 2021). Sur les médias sociaux, les contenus relatifs à l'image corporelle sont davantage susceptibles d'être utilisés pour se comparer : provenant le plus souvent de pairs, ils donnent un sentiment de proximité et d’accessibilité (Fardouly et al., 2017).
La théorie de la comparaison sociale de Festinger (1954) énonce que les personnes évaluent leurs propres compétences et leurs propres traits en se comparant à autrui. Mais dans le cas des médias sociaux, cette comparaison est inéquitable, car les images partagées sont transformées à l'avantage de la personne représentée. La comparaison est alors ascendante, c’est-à-dire qu’elle réside entre soi et les personnes qui correspondent plus que soi à l’idéal à atteindre, pouvant ainsi conduire à une insatisfaction corporelle (Bocage-Barthélémy et al., 2018). Par ailleurs, en se concentrant sur l'image, les médias sociaux encouragent à réduire la valeur du corps à son apparence physique plutôt qu'à sa fonctionnalité, renforçant la tendance à considérer le corps comme un objet à perfectionner et à transformer (Fioravanti et al., 2023). Cette perspective est liée à l'auto-objectivation, un concept développé par Fredrickson et Roberts (1997) et repris récemment en santé virtuelle corporelle (Monthuy-Blanc et al., 2022); elle implique d’évaluer constamment notre corps. Cette tendance nous amène à vivre des expériences négatives liées à notre image corporelle, telles que la culpabilité et la honte corporelles.
L’émergence d’ACA dysfonctionnels
L'exposition constante à des images de corps à la fois minces, jeunes et musculeux sur les médias sociaux incite les utilisateurs à idéaliser ces corps. Cette dynamique peut entraîner une perception négative de leur propre corps, considéré comme imparfait et nécessitant une transformation rapide (Aparicio-Martinez et al., 2019); c’est un terreau fertile aux ACA dysfonctionnels, incluant les troubles des conduites alimentaires (TCA).
Les ACA peuvent être conceptualisés sur un continuum d’intensité, allant des plus fonctionnels (en visant l’alimentation intuitive) aux plus dysfonctionnels (état clinique de TCA). Les études rapportent que près de 48 % de la population présente des ACA dysfonctionnels (Monthuy-Blanc et al., 2022). Ces manifestations sont particulièrement criantes chez les personnes vulnérables comme les jeunes en mutation corporelle, les populations cliniques avec obésité vivant des défis corporels, physiques et sociaux, la communauté LGBTQ+ en questionnement et en transformation corporelle, ainsi que la population sportive qui objective son corps à des fins de performance, et ce, tous genres confondus. Certaines études ont montré en outre que les personnes à dominante masculine exposées à des images idéalisées sur les médias sociaux peuvent également développer des préoccupations excessives concernant leur apparence physique (Perloff, 2014).
Conclusion
Souvent invisibles, les enjeux alimentaires et les perceptions du soi physique négatives révèlent la pertinence d’interventions au plus près des populations à risque (Monthuy-Blanc et al., 2022). Pour ce faire, un changement profond des contenus proposés sur les médias sociaux demeure nécessaire. À titre d’exemple, le mouvement du body-positivisme , auparavant considéré comme une solution, est aujourd’hui critiqué pour sa surévaluation de l'apparence physique dans la définition du soi, au détriment d’autres attributs (ex. : la personnalité; Hallward et al., 2023). Ce sont les contenus détachés de propos ou d’images corporels qui contribuent majoritairement à une image corporelle positive (Rodgers et al., 2021). Valoriser le corps pour ce qu'il peut accomplir, indépendamment de ses caractéristiques physiques, en misant sur la reconnexion et l’acceptation corporelle (complète ou partielle) par l’alimentation intuitive, devient une avenue à exploiter dans le milieu de vie comme en intervention clinique (Alleva et Tylka, 2021).
La santé des populations s’inscrit dans cette logique; elle nécessite de développer des aptitudes liées au bien-être alimentaire et corporel en privilégiant l’autonomie et le pouvoir d’agir. Les instances gouvernementales se sont positionnées en ouvrant de nouvelles avenues en politique préventive de la santé. C’est à ce titre que le Plan d’action interministériel en santé mentale 2022-2026 met de l’avant l’innovation numérique en santé (santé virtuelle, santé mobile, etc.) pour « améliorer l’accès aux soins et aux services en santé mentale » (MSSS, 2022A, p. 22).
Références
- Alleva, J. M. et Tylka, T. L. (2021). Body functionality: A review of the literature. Body Image, 36, 149-171.
- Aparicio-Martinez, P., Perea-Moreno, A. J., Martinez-Jimenez, M. P., Redel-Macías, M. D., Pagliari, C. et Vaquero-Abellan, M. (2019). Social media, thin-ideal, body dissatisfaction and disordered eating attitudes: An exploratory analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(21), 4177.
- Bocage-Barthélémy, Y., Chatard, A., Jaafari, N., Tello, N., Billieux, J., Daveau, E., Selimbegović, L. et Kavushansky, A. (2018). Automatic social comparison: cognitive load facilitates an increase in negative thought accessibility after thin ideal exposure among women. Plos One, 13(3).
- Cash, T. F. (2012). Cognitive-behavioral perspectives on body image. Dans T. F. Cash (dir.), Encyclopedia of body image and human appearance, 334-342. Elsevier Academic Press.
- Cwynar-Horta, J. (2016). The commodification of the body positive movement on Instagram. Stream: Interdisciplinary Journal of Communication, 8(2), 36-56.
- Fardouly, J., Pinkus, R. T. et Vartanian, L. R. (2017). The impact of appearance comparisons made through social media, traditional media, and in person in women’s everyday lives. Body Image, 20, 31-39.
- Festinger, L. (1954). A Theory of Social Comparison Process. Human Relations, 7, 117-140.
- Fioravanti, G., Bocci Benucci, S., Vinciarelli, V. et Casale, S. (2023). Body shame and problematic social networking sites use: the mediating effect of perfectionistic self-presentation style and body image control in photos. Current Psychology, 1-12.
- Fredrickson, B. L. et Roberts, T. A. (1997). Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173-206.
- Hallward, L., Feng, O. et Duncan, L. R. (2023). An exploration and comparison of #BodyPositivity and #BodyNeutrality content on TikTok. Eating Behaviors, 101760.
- Monthuy-Blanc, J., Bouchard, S., Ouellet, M., Corno, G., Iceta, S. et Rousseau, M. (2020). “eLoriCorps Immersive Body Rating Scale”: Exploring the Assessment of Body Image Disturbances from Allocentric and Egocentric Perspectives. Journal of Clinical Medicine, 9(9), 2926.
- Monthuy-Blanc, J., Corno, G., Bouchard, S., St-Pierre, M.-J., Bourbeau, F., Mostefa-Kara, L., et Rousseau, M. (2022). Body perceptions, occupations, eating attitudes, and behaviors emerged during the pandemic: An exploratory cluster analysis of eaters profiles. Frontiers in Psychology, 13, 949373.
- Perloff, R. M. (2014). Social media effects on young women’s body image concerns: Theoretical perspectives and an agenda for research. Sex Roles, 71, 363-377.
- Rodgers, R. F., Paxton, S. J. et Wertheim, E. H. (2021). #Take idealized bodies out of the picture: A scoping review of social media content aiming to protect and promote positive body image. Body Image, 38, 10-36.
- Saiphoo, A. N. et Vahedi, Z. (2019). A meta-analytic review of the relationship between social media use and body image disturbance. Computers in Human Behavior, 101, 259-275.
- Schimmele, C. M., Fonberg, J. D., Schellenberg, G., Statistique Canada et Bibliothèque numérique canadienne (firme). (2021). Évaluations que font les Canadiens des médias sociaux dans leur vie. Statistique Canada (Rapports économiques et sociaux). Consulté en 2023.