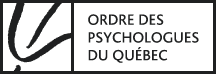Introduction au dossier – Parentalité et système familial

Professeur émérite en psychologie de l’enfant et de la famille à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il est associé à plusieurs unités de recherche au Québec et à l’étranger. Tout au long de sa carrière, il a oeuvré à développer des manières respectueuses et éthiques de travailler avec des enfants et des parents, et ce, dans le cadre de divers contextes sociaux et institutionnels.
La parentalité est un terme relativement récent dans le langage professionnel et scientifique, et sa principale fonction est de souligner le besoin que l’enfant a de ses parents (Latuillière, 2015). Ce terme sert à englober la mère et le père (biologiques ou adoptifs), mais aussi toute autre personne qui assume, dans les faits, une délégation du rôle parental auprès d’un enfant : notamment un beau-parent ou un(e) conjoint(e) dans une famille recomposée, ou un parent d’une famille d’accueil. La complexité sous-jacente au phénomène de la parentalité exige des efforts de définition et de conceptualisation.
Sur ce plan, dans la documentation scientifique, un consensus semble se dégager autour d’un modèle conceptuel de la parentalité constitué de trois axes (Houzel, 1999; Lacharité et al., 2015; Sellenet, 2007) :
- L’axe de l’exercice (ou de la responsabilité) parental, à savoir l’ensemble des obligations ou des devoirs juridiques, sociaux et culturels associés à ce rôle (incluant le partage des responsabilités avec d’autres figures parentales);
- L’axe de la pratique parentale, à savoir les gestes, les décisions ou les habiletés relatives à la réponse aux besoins de l’enfant ; cela inclut la coordination de ses actions avec celles des autres personnes qui s’occupent de ce dernier, notamment l’autre parent, ce qui donne lieu au phénomène de la coparentalité;
- L’axe de l’expérience parentale, à savoir tout ce qui habite la personne lorsqu’elle adopte son rôle de parent (les savoirs, les valeurs, les attentes, les souvenirs, les rêves, les inquiétudes, les émotions, le stress, le sentiment de compétence, etc.). De plus, la notion de parentalité telle que définie dans ce modèle conceptuel sert à placer l’exercice du rôle parental sous le regard de l’action publique (Lacharité et al., 2015; Sellenet, 2007). Dès lors, parler de la parentalité d’une personne représente un discours en surplomb de ce que celle-ci vit au quotidien et une façon de conceptualiser ce phénomène au-delà du sens premier que cette personne attribue à ce quotidien parental. Cette notion sert donc d’appui à une perspective évaluative de la responsabilité, de la pratique et de l’expérience parentales en permettant à la parentalité d’être déclarée « positive » (Vallerand, 2018) ou encore « défaillante » ou « incompétente » (Pothet, 2023).
Considérer la parentalité en tant qu’élément du système familial
De nos jours, lorsqu’on évoque la famille d’un enfant dans les politiques publiques, dans les recherches et même dans les médias, celle-ci est souvent réduite aux parents de l’enfant, pris individuellement (sa mère ou son père) ou en couple (intact, séparé ou recomposé). Cette tendance se situe en porte-à-faux d’une conception généreuse et dynamique de la famille en tant que système humain qui est plus que la somme de ses parties (Watson, 2012), et qui est lui-même inséré à l’intérieur d’un écosystème plus large (Guy-Evans, 2024). Or, considérer la parentalité en tant qu’élément du système familial nous invite à concevoir le fait qu’être parent est plus que la somme des responsabilités, des habiletés et des émotions d’une personne. Une approche systémique de la parentalité implique en effet la prise en compte d’une multiplicité de facteurs, internes et externes, qui façonnent la réalité parentale. Une telle approche nous rappelle également la complexité de la parentalité. Cette conception systémique de la parentalité a aussi une incidence sur les interventions professionnelles auprès des parents, que celles-ci soient directes (ex. : lorsqu’une mère sollicite de l’aide psychologique en lien avec un état d’épuisement parental) ou indirectes (ex. : lorsqu’un père participe à un plan d’intervention pour son enfant présentant un trouble oppositionnel).
C’est justement ce croisement entre parentalité et système familial que les contributions de ce dossier cherchent à explorer. Cette édition sur le thème « parentalité et thérapie familiale » comporte en tout sept articles, dont deux sont disponibles en exclusivité dans la version numérique du magazine.
Les deux textes Web ont en commun de se pencher sur le phénomène de la séparation conjugale sous l’angle des enjeux relatifs à la parentalité. Abate et Paquin-Boudreau attirent notre attention sur la séparation conjugale pendant la période périnatale et la petite enfance et sur ce que cet événement peut impliquer sur le plan des conflits entre les conjoints et de la collaboration coparentale autour de l’enfant. Durant cette période critique dans le développement du jeune enfant, l’engagement des deux parents dans des pratiques parentales sensibles aux besoins de l’enfant s’avère un important facteur de protection pour ce dernier face aux perturbations suscitées par une séparation conjugale. De leur côté, Larouche, Pierce et Dubeau abordent la séparation conjugale sous l’angle de la perspective qu’en ont les pères. L’argument qu’ils soutiennent, de manière éloquente, est que les mères et les pères n’affrontent pas de la même façon les défis qui émergent d’une séparation. Par conséquent, leur adaptation personnelle et parentale comporte des enjeux et repose sur des formes de soutien qui leur sont propres, en particulier en ce qui concerne le maintien de leur engagement envers leur(s) enfant(s) après la séparation.
Parmi les articles regroupés dans ce magazine, trois touchent au thème de la parentalité. Langevin et Montreuil abordent le phénomène de la transition à la parentalité dans la période périnatale chez les parents ayant vécu des expériences de maltraitance au cours de leur enfance ou de leur adolescence. D’une part, le caractère traumatique de ces expériences a des répercussions notables sur la façon dont la mère ou le père composent avec les multiples responsabilités associées à l’arrivée d’un enfant dans leur vie. D’autre part, cette période constitue aussi une source de possibilités pour ces personnes. L’accès à des interventions psychologiques à ce moment permet de mobiliser ces possibilités dans une perspective de prévention des difficultés dans la relation parent-enfant et dans le développement de l’enfant. Quant à l’auteure Bouchard, elle nous invite à faire un saut à l’autre bout du continuum de la parentalité, à savoir le moment où l’enfant devient adulte et quitte la maison pour faire sa vie, créant ainsi le phénomène du « nid déserté ». Pour les parents, cela correspond à un changement de statut dans leur relation avec leur enfant : ils acquièrent alors ce qu’elle nomme judicieusement le « statut de parent émérite ». Dans son article, elle explore les défis personnels, parentaux et conjugaux associés à ce nouveau statut et à cette nouvelle étape dans le cycle de vie familial. L’article de Côté-Séguin et Sabourin aborde quant à lui un contexte de services particulier – l’évaluation neurodéveloppementale de l’enfant – et la prise en considération de l’expérience qu’en ont les parents. Elles décrivent les réactions émotionnelles qui émergent de ce processus d’évaluation clinique ainsi que les mécanismes d’adaptation que les parents mobilisent dans ce contexte. Cette description sert de repère pour l’accompagnement des parents. Les deux autres articles de ce dossier abordent de front le thème de la thérapie familiale. L’article de Roberge interroge la place de l’enfant – sa perspective, sa voix – dans les séances de psychothérapie familiale. Elle souligne la difficulté des psychothérapeutes à « traiter conjointement des adultes et des enfants » et leur propension à marginaliser, voire à négliger, les plus jeunes. Dans la foulée de cet argumentaire, l’autrice explore diverses stratégies d’intervention qu’elle illustre par des vignettes cliniques. Finalement, Laberge se penche sur le génogramme, un outil largement utilisé en intervention familiale depuis les années 1970. D’emblée, l’autrice pose le problème de la représentation sociale de la famille et de sa profonde évolution au fil des ans. En utilisant cet outil, risque-t-on de fonder notre intervention sur une conception caduque de la famille? Est-il possible d’en penser une utilisation qui repose sur une conception moderne de la famille? Elle répond par l’affirmative à ces deux questions et propose une utilisation actualisée du génogramme par les psychologues.
Nous espérons que ce dossier saura alimenter une réflexion sur votre travail d’intervention ou de recherche, que celui-ci porte directement sur les parents et les familles ou qu’il touche indirectement des personnes qui sont membres d’une famille ou qui exercent des responsabilités parentales.
Bibliographie
- Guy-Evans, O. (2012). Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory. Simply Psychology.
- Houzel, D. (1999). Les enjeux de la parentalité. Érès.
- Lacharité, C., Pierce, T., Calille, S., Baker, M., Pronovost, M. (2015). Les Cahiers du CEIDEF : vol. 3. Penser la parentalité au Québec : un modèle théorique et un cadre conceptuel pour l’initiative Perspectives parents. Éditions CEIDEF.
- Latuillière, M. (2015). Qui dit parentalité?. Spirale, 75, 15-22.
- Pothet, J. (2023). La parentalité, un levier politique face aux troubles à l’ordre public? The Conversation.
- Sellenet, C. (2007). La parentalité décryptée, pertinence et dérives d’un concept. L’Harmattan.
- Vallerand, N. (2018). La parentalité positive expliquée. Naître et grandir.
- Watson, W. H. (2012). Family Systems. Encyclopedia of Human Behavior (2e éd.).